S'en aller sans retour
Un roman de Francisco
Arcis, publié au Seuil,
en 2008, dans la collection Karactère(s).
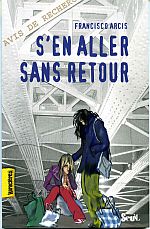 Angélique
trouve
que ses parents se désintéressent d'elle, parce qu'elle
a 16 ans et qu'elle est "grande". Elle sort souvent, rentre tard ou le
lendemain sans que ses parents ne s'en inquiètent. Elle estime
que son père ne sait que lui poser des interdictions, rien
d'autre.
Angélique
trouve
que ses parents se désintéressent d'elle, parce qu'elle
a 16 ans et qu'elle est "grande". Elle sort souvent, rentre tard ou le
lendemain sans que ses parents ne s'en inquiètent. Elle estime
que son père ne sait que lui poser des interdictions, rien
d'autre.
Elle décide donc de partir. Un matin, elle met
dans son sac de
cours deux bouteilles de lait, deux paquets de
gâteaux secs et deux paquets de clopes piqués dasn la
cartouche de son
père, elle traîne un peu au centre commercial au lieu
d'aller au lycée, puis elle prend le train pour Lyon.
A
elle la liberté !
Très vite, il lui faut résoudre
quelques
problèmes pratiques : dormir, se nourrir, se laver. Le premier
soir, elle loge chez une étudiante rencontrée un samedi soirau cours
d'une virée. Mais comme elle fait des études
d'assistante sociale, elle choisit de ne pas s'attarder... Elle a
envoyé un message à sa copine, laquelle lui fait part
de l'inquiétude de ses parents. Emue, elle rentrerait bien,
mais elle croise Ludmilla. Cette fille qui vit dans la rue la repère
à ses cheveux encore propres. Elle lui apprend à
mendier, à zoner sans se faire prendre. Elle lui fait voir un
squatt bien crasseux pour qu'elle réalise qu'il vaut mieux
dormir la nuit sous les ponts de la Saône. Les journées
des deux filles sont entièrement occupées à leur
survie : avoir un peu d'argent, manger, être en éveil
pour ne pas se faire repérer, trouver où dormir...
Vivre dans la rue en refusant toute aide est usant et dégrade
rapidement le corps. Ludmilla s'affaiblit. Une nuit, elle commence à
cracher du sang. Au matin, profitant de son inconscience, Angélique
dépose Ludmilla dans une clinique et se décide à
rentrer.
La
narratrice raconte son
mal-être d'adolescente, sa rébellion, sa décision
irréfléchie de partir pour être libre, sa vie
dans la rue, son amitié avec l'autre fille. A la lecture, on
décèle nettement l'écart existant entre le rêve
d'être libre et la dure réalité de la vie dans la
rue.
Le
roman est centré
sur la fugue de l'adolescente. On ne saura que peu de choses de ce
qui l'a conduite à partir, sauf la solitude dans laquelle elle
se trouve à ce moment de sa vie, l'apparent désintérêt
de ses parents. Ce choix de l'auteur permet de mieux montrer la
réalité de la vie d'une fugueuse : la mendicité,
la faim, le froid, la saleté, le recours à l'alcool, le
risque sexuel, la solitude, la sensation d'inexistence. L'absence de
relations avec des gens "normaux" crée un risque de
dégradation morale et physique aboutissant au mieux dans un
service d'urgences hospitalières. C'est ce qui se passe pour
Ludmilla. C'est ce qui choque Angélique et qui laisse penser
qu'elle retrouvera le chemin de la normalité.
Ce
texte est bien écrit.
Avec ce qu'il faut pudeur, l'auteur laisse deviner sans les décrire,
ce que pourraient être certaines situations violentes ou
sordides. Il montre qu'il est sensible à ces situations de
détresse. Il précise d'ailleurs que l'idée de ce
livre lui est venue alors qu'il venait de déclarer la fugue
d'une jeune fille coutumière du fait et qui savait
disparaître. C'est un texte de prévention plus que
d'émotion, un texte qui décrit avec lucidité la
vie d'une fugueuse, qui affronte le rêve de liberté de
la fugue.
Ce roman a le mérite de rappeler aux adultes que
la fugue est toujours un risque, qu'elle est toujours un
danger, que les adolescents peuvent ne jamais remonter la pente. Aux
adolescents, il souligne qu'elle est une liberté qui, à
terme, se paye toujours trop cher, lorsqu'elle ne rapporte
plus que de
la solitude, de la misère et de la souffrance.
Pour des lecteurs de 12-13 ans.
© Jean TANGUY 14 septembre 2008