| |
|
Shabanu
Un
roman de Suzanne Fisher Staples,
édité chez Gallimard
en 1993,
dans la collection Page blanche.
Traduit de l'anglais.
 Dans le
désert du Cholistan, au sud du Pakistan, vit un peuple de
nomades qui élèvent des chameaux. Leur vie semble
la même depuis des siècles. Dans le
désert du Cholistan, au sud du Pakistan, vit un peuple de
nomades qui élèvent des chameaux. Leur vie semble
la même depuis des siècles.
Shabanu, la fille du vent, est la fille du chef Dalil Abassi. Sa soeur,
Phulan, treize ans, va bientôt être
mariée. Ce sera ensuite le tour de Shabanu qui est promise
à Murad, un homme jeune. Mais une rixe vient bouleverser ce
plan. Le fiancé de Phulad est tué et, ainsi que
le veut la coutume, elle est mariée à Murad. Au
grand désespoir de Shabanu qui est remarquée par
Rahim, l'oncle de Murad, un homme de 48 ans, riche et déja
marié. Difficile de refuser, surout parce qu'elle sait que
son mariage amènera la prospérité sur
sa famile...
Mais Shabanu, au cours des préparatifs de la noce, rencontre
une de ses tantes, Sharma, qui vit seule avec sa fille. Elle n'a pas
une conception traditionnelle des relations entre les hommes et les
femmes. Elle apprend à Shabanu que l'essentiel est de garder
cachées ses ressources intérieures ,
qu'elle peut être mariée à un homme de
55 ans et préserver sa plus totale liberté.
Shabanu va-t-elle suivre les conseils de sa tante et rompre avec les
traditions millénaires de son peuple et de sa religion ?
L'auteur est journaliste
et a vécu plusieurs années au Pakistan. Elle
brosse un magnifique portrait d'une jeune fille musulmane impertinente
et courageuse, qui, sans s'être frottée
à la modernité urbaine occidentale,
décide de choisir sa vie.
Ce roman est une chronique relatant à la façon
d'un documentaire, la vie d'un peuple de nomades du désert,
leurs habitudes tribales et communautaires, leur traditionnalisme
culturel et religieux, leur métier d'éleveurs de
chameaux. Le cadre est bien dessiné et les personnages bien
campés dans une réalité quotidienne
-le désert- non située dans le temps.
Il se lit à deux niveaux. Ce qu'il nous décrit
peut être une actualité résultant d'une
culture inchangée depuis plus de 25 siècles,
présentée comme un fait brut, sans juger , sans
remettre en cause. Par certains aspects, ce texte est un document
ethnologique. Mais en même temps, la jeune fille prend
conscience que sa condition peut évoluer. Cette prise de
conscience tramée dans le tissu de la vie quotidienne de
Shabanu et de sa famille, se présente comme une
méditation sur leur histoire, une prise de distance
prémice d'une contestation.
Ce livre de 250 pages captive le lecteur. On est tenu en haleine,
emporté par la puissance évocatrice du texte,
fasciné par la beauté du cadre ,
étreint par le drame que subissent les personnages. Et on se
prend d'espoir pour Shabanu, la "fille du vent" ...
Pour des bons lecteurs et lectrices de 14-15 ans et
plus.
© Jean TANGUY --
24 juillet 2000.
|
|
Haveli
Un
roman de Suzanne Fisher Staples,
édité chez Gallimard
en 1993,
dans la collection Page blanche.
Traduit de l'anglais.
 A douze ans, Shabanu est devenue la
quatrième femme de Rahim, un homme de quarante-huit ans que
sa famille lui a choisi. Elle ne lui a donné qu'une fille,
Mumtaz. Elle veille à ce qu'elle reste unique, pour garder
son attrait physique et parce qu'elle sait que si elle donnait la vie
à un garçon, les autres femmes de Rahim se
ligueraient pour le supprimer. Mais elle a de la chance, Rahim l'aime
et elle a appris à l'aimer. Cet amour ne l'aveugle pas, elle
sait que lorsque Rahim mourra, elle sera en danger dnas ce village
rural du Pendjab. Elle veut aller vivre à Lahore, dans la Haveli,
la vieille demeure familliale dont aucune des femmes ne veut,
préférant le confort moderne d'une villa neuve.
C'est là qu'elle espère, un jour, mener son
existence comme elle l'entend, agir plus librement, élever
sa fille loin des intrigues des autres épouses. A douze ans, Shabanu est devenue la
quatrième femme de Rahim, un homme de quarante-huit ans que
sa famille lui a choisi. Elle ne lui a donné qu'une fille,
Mumtaz. Elle veille à ce qu'elle reste unique, pour garder
son attrait physique et parce qu'elle sait que si elle donnait la vie
à un garçon, les autres femmes de Rahim se
ligueraient pour le supprimer. Mais elle a de la chance, Rahim l'aime
et elle a appris à l'aimer. Cet amour ne l'aveugle pas, elle
sait que lorsque Rahim mourra, elle sera en danger dnas ce village
rural du Pendjab. Elle veut aller vivre à Lahore, dans la Haveli,
la vieille demeure familliale dont aucune des femmes ne veut,
préférant le confort moderne d'une villa neuve.
C'est là qu'elle espère, un jour, mener son
existence comme elle l'entend, agir plus librement, élever
sa fille loin des intrigues des autres épouses.
Mais cela ne se fera pas sans difficultés. Quand elle
rencontre Omar, le fils du frère de Rahim, qui revient de
New-York, elle tombe amoureuse de ce bel homme jeune et
évolué. Elle sait pourtant que leur union sera
impossible. Elle sait même que si leur amour mutuel vient au
jour, elle, surtout, sera en danger. Des
événements graves lui imposent de se
séparer de Mumtaz, qu'elle met en garde dans sa famille qui
élève toujours des chameaux dans le
désert du Cholistan. Elle perd tragiquement Zabo, sa seule
amie, alors qu'elles s'enfuyaient dans le désert. Pour
rester en vie, il ne lui reste plus qu'une solution : vivre
clandestinement dans l'étage inutilisé de la
Haveli, avec la complicité d'une servante, sans plus avoir
de nouvelles de sa fille, symbole sa liberté, ni d'Omar,
symbole de son amour. Vivre avec l'espoir au coeur.
J'ai
beaucoup aimé ce portrait de femme qui, dans des
circonstances difficiles, refuse toute compromission pour garder son
intégrité, sa pureté, sa
liberté.
Le roman est épais, mais la succession des rebondissements
garde intact l'intérêt pour l'histoire. Le cadre
est toujours magnifique, que l'action se passe dans le village, dans le
désert ou dans le vieux quartier de Lahore.
On peut être gêné par les mots
écrits en Pendjabi, même traduits dans le
glossaire, et par quelques erreurs de traduction en fin d'ouvrage.
Un beau texte écrit par une journaliste qui a
rencontré des tribus nomades dans le désert du
Cholistan. C'est peut-être ce qui donne de tels accents de
vérité à son texte.
Texte
publié dans "Echanges-22", fin 1993. © Jean TANGUY
|
|
Afghanes
Un
roman de Suzanne Fisher Staples,
édité chez Gallimard
en 2006,
dans la collection Scripto.
Traduit de l'anglais.
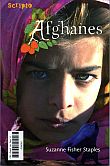 2001, en Afghanistan. 2001, en Afghanistan.
Nushrat habite Peshawar. Elle est américane d'origine et
s'est mariée à un médecin pakistanais
pour lequel elle a eu le coup de foudre. Par amour, elle s'est
convertie
à l'islam et a décidé de venir habiter
avec lui dans ce pays qui est sous la coupe des tablibans. Pendant que
Faiz est en mission au nord du pays, Nusrat donne des cours
à
des enfants réfugiés. Ce sont souvent des enfants
très affaiblis que lui envoie le gardien du camp voisin
parce qu'il sait qu'elle les nourrira le midi.
Najmah vit dans un village au nord de l'Afghanistan. Sa famille est
propriétaire d'un petit troupeau et de quelques terres. Sa
mère est enceinte et va accoucher d'un garçon.
Mais les talibans passent et emmènent Nur, son
frère aîné et son père.
Quelques semaines plus tard, ce sont les avions qui passent,
bombardant le village et tuant sa mère et son
bébé. Un jeune couple de voisins la recueillent
et l'emmène avec eux. Ils lui ont coupé les
cheveux et luuiont donné des vêtements de
garçons pour qu'elle soit moins en danger sur les routes.
Après un long et difficile voyage, ils arrivent
à Peshavar. Le gardien du camp la remarque et
l'envoie chez Nushrat.
Cele-ci devine de suite que sous les habits de garçon, il y
a une jeune fille. Elle devine aussi qu'elle a vécu de
douloureuses épreuves et qu'elle est en danger. Elle la
prend sous sa protection.
Des mois plus tard, Najmah retrouve son frère, apprend la
mort de son père. Il sdécident de repartir dasn
leur village, vivre sur les terres fammiliales. Nusrat apprend le
décès de son mari. Sans renier ce qu'elle a
vécu jusqu'alors, elle décide de revenir aux
Etats-Unis vivre auprès de ses parents.
Susan
Fisher Staples explique sur son
site (en anglais) que son roman est basé
sur des faits réels, même l'histoire de Najmah.
Journaliste pour United
Press International, elle a effectué plusieurs
séjours en Afghanistan.
Ce
roman met à
nouveau des femmes en scène, dans un
monde où on les
imagine discrètes et soummises à un
islam
traditionnaliste. Pourtant, c'est avec sa famille
américaine que Nusrat est dans une relation
d'incompréhension, ses parents considérant qu'ils
l'ont
perdues lorsqu'elle s'est convertie à l'islam. Pourtant,
Nusrat pratique un islam modéré, ouvert et
moderne. Elle dit, d'ailleurs qu'elle croit que Dieu se moque du nom
qu'on lui donne. Sa vision de la religion met en
valeur l'intégrisme exagérément
rigoureux des talibans.
Au début, les chapitres alternent le récit de
Najmah et Nusrat. Najmah narre elle-même son
hisotire alors qu'un narateur externe parle pour Nusrat. A partir du
moment où Haroun, le gardien du camp, amène
Najmah chez Nusrat, les deux voix se
mêlent dans les mêmes chapitres, Najmah
continuant à dire "je". Cette façon
d'écrire donne du charme au roman.
Puis, Najmah ayant muri, décide de repartir avec son
frère sur les terres de sa famille, aux pieds de la montagne
qui abrite l'âme de leurs ancêtres. Seule, Nusrat
ne peut rester à Peshawar, le gouvernement ne la laisserait
pas vivre sans mari. Elle se rappelle que le nom
que lui a donné son mari signifie "celle qui aide", que son
choix de vie a privé ses parents de sa présence
et que le temps est venu de renouer avec eux en retournant aux
Etats-Unis. Elle n'oublie pas cette expérience de vie, sa
tolérance et la violence de ce pays. Pour l'une et
l'autre, c'est la marque de leur fidélité.
Cette histoire
très documentée est une belle leçon de
courage, de tolérance, d'amour. La petite fille afhgane d'un
petit éleveur et la jeune femme d'une bonne
famille américaine ont en commun d'être des femmes
d'honneur, droites, fidèles : de grandes dames.
On
retiendra aussi que la journaliste anglaise nous fait voir la situation
de ce pays sans porter de jugement. A chacun de se faire son
opinion.
pour lecteurs et lectrices de 12-13 ans et plus.
© Jean TANGUY -- 10 mai
2007.
|
|

 A douze ans, Shabanu est devenue la
quatrième femme de Rahim, un homme de quarante-huit ans que
sa famille lui a choisi. Elle ne lui a donné qu'une fille,
Mumtaz. Elle veille à ce qu'elle reste unique, pour garder
son attrait physique et parce qu'elle sait que si elle donnait la vie
à un garçon, les autres femmes de Rahim se
ligueraient pour le supprimer. Mais elle a de la chance, Rahim l'aime
et elle a appris à l'aimer. Cet amour ne l'aveugle pas, elle
sait que lorsque Rahim mourra, elle sera en danger dnas ce village
rural du Pendjab. Elle veut aller vivre à Lahore, dans la Haveli,
la vieille demeure familliale dont aucune des femmes ne veut,
préférant le confort moderne d'une villa neuve.
C'est là qu'elle espère, un jour, mener son
existence comme elle l'entend, agir plus librement, élever
sa fille loin des intrigues des autres épouses.
A douze ans, Shabanu est devenue la
quatrième femme de Rahim, un homme de quarante-huit ans que
sa famille lui a choisi. Elle ne lui a donné qu'une fille,
Mumtaz. Elle veille à ce qu'elle reste unique, pour garder
son attrait physique et parce qu'elle sait que si elle donnait la vie
à un garçon, les autres femmes de Rahim se
ligueraient pour le supprimer. Mais elle a de la chance, Rahim l'aime
et elle a appris à l'aimer. Cet amour ne l'aveugle pas, elle
sait que lorsque Rahim mourra, elle sera en danger dnas ce village
rural du Pendjab. Elle veut aller vivre à Lahore, dans la Haveli,
la vieille demeure familliale dont aucune des femmes ne veut,
préférant le confort moderne d'une villa neuve.
C'est là qu'elle espère, un jour, mener son
existence comme elle l'entend, agir plus librement, élever
sa fille loin des intrigues des autres épouses.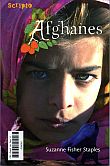 2001, en Afghanistan.
2001, en Afghanistan.